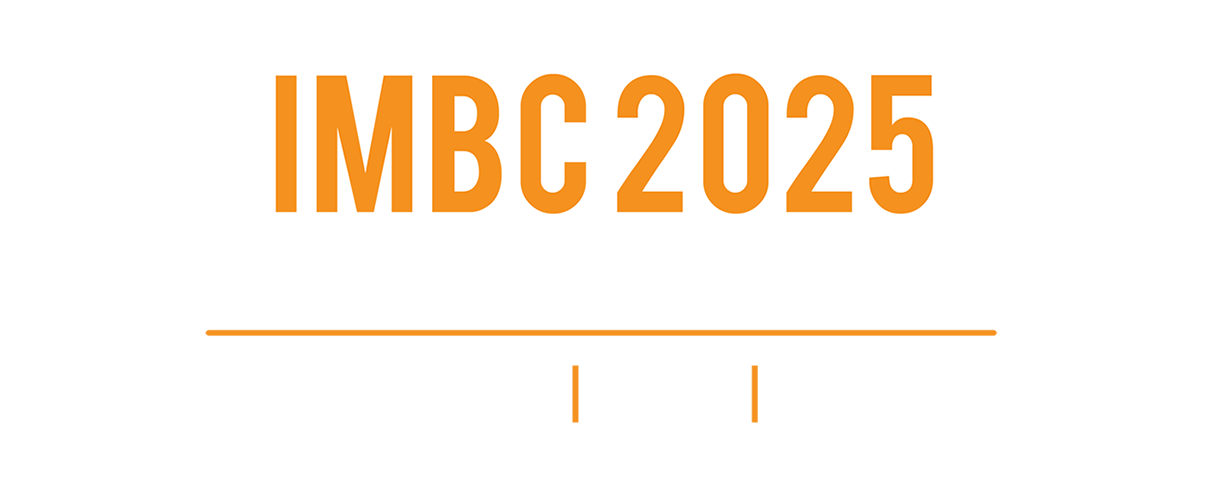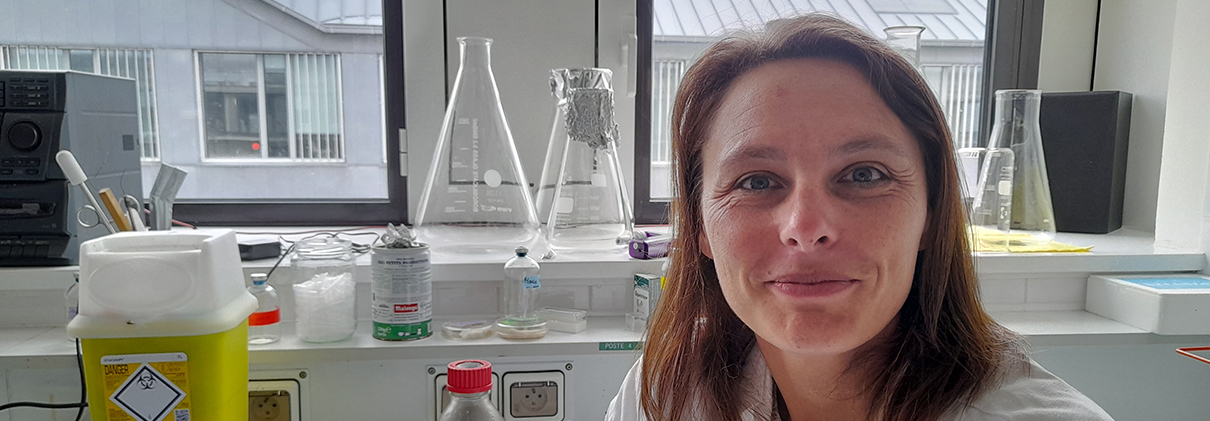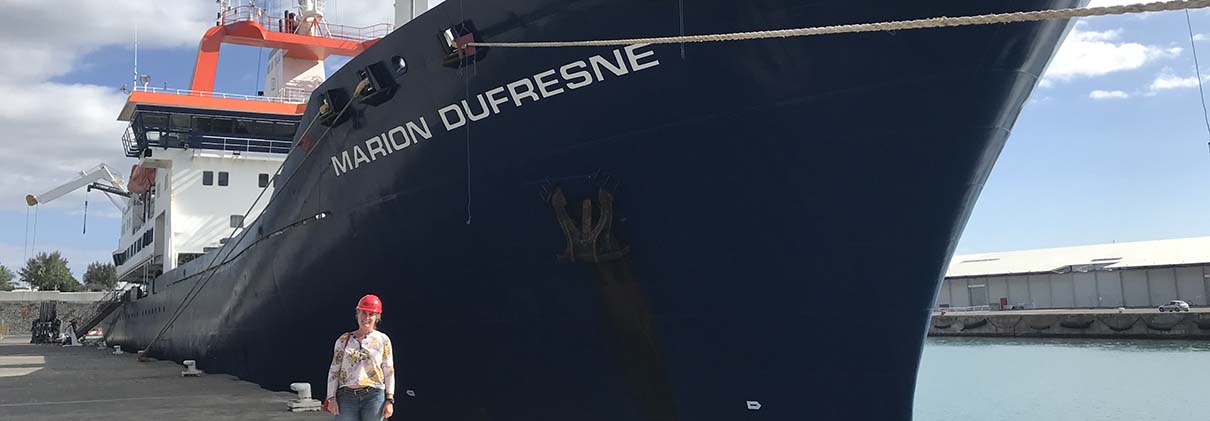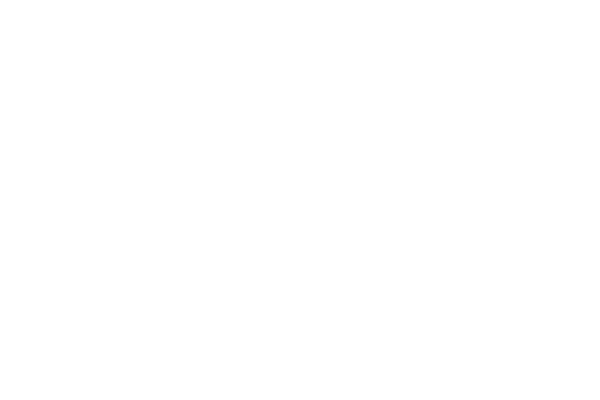Troisième forum frontalier Chine-Europe sur les progrès des sciences et technologies océaniques
Le troisième forum frontalier Chine-Europe sur les progrès des sciences et technologies océaniques (FFPOST2) s’est tenu à Shanghai et on-line les 18 et 19 novembre 2024. Il était organisé par Paul Tréguer (IUEM-UBO, European Academy of Sciences EurASc) et Jing Zhang (ECNU, Chinese Academy of Sciences), dans le cadre de la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030).
Une cinquantaine de participants ont assisté à l’événement, avec des retransmissions en direct qui ont été suivies par environ 6 000 personnes. Vingt-quatre orateurs invités ont présenté des communications. Les progrès sont remarquables en ce qui concerne l’utilisabilité des océans jumeaux de Ditigal et de l’IA en physique et biogéochimie et en gestion côtière. Tous les déploiements de systèmes d’élimination du dioxyde de carbone (CDR) entraîneront un efflux compensatoire de CO2 ou une réduction de l’afflux à partir de tous les réservoirs naturels, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des systèmes réalistes d’élimination du dioxyde de carbone sur terre, dans les océans et dans les eaux bleues. Les puits de carbone dus à la pêche sont en cours d’évaluation, et l’extension de la zone de minimum d’oxygène a été démontrée. Les impacts de l’élévation du niveau de la mer et des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur sont des questions clés pour l’avenir proche. Les premiers coûts économiques de l’inondation des côtes sont désormais disponibles. Les progrès spectaculaires des outils et des réseaux d’observation de l’océan ont été mis en évidence.
Pour des information plus détaillées, un rapport synthétique est disponible sur ce lien.