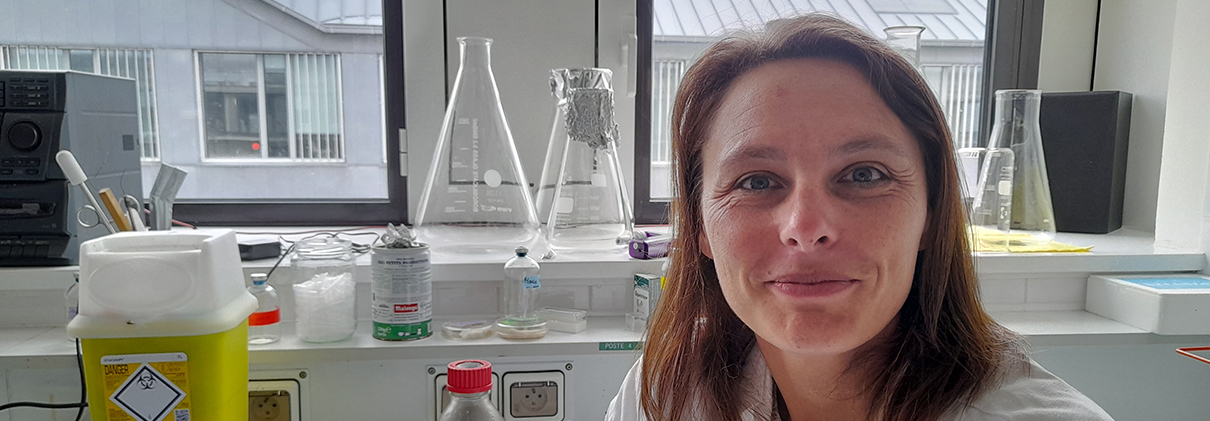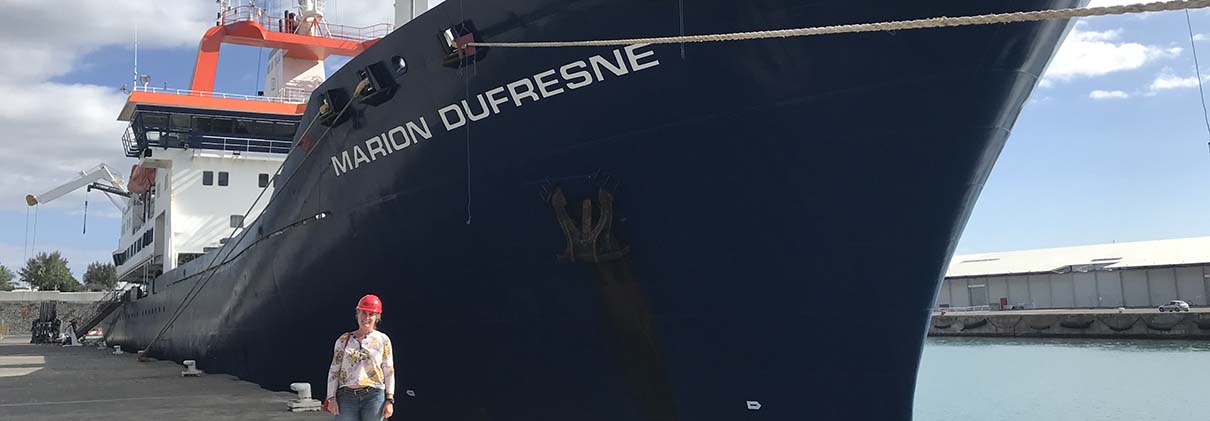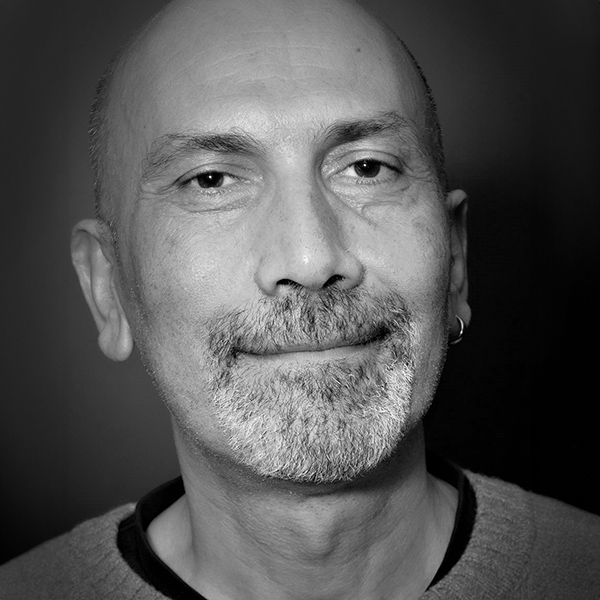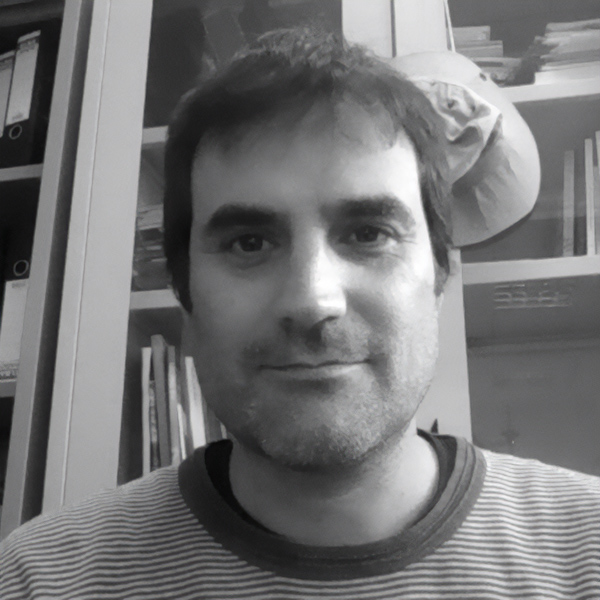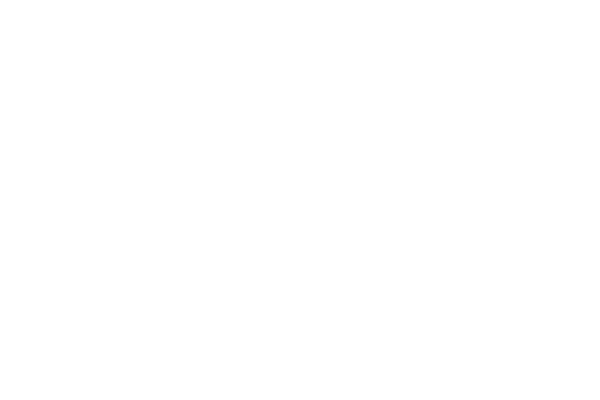Réunions internationales des PHC Toubkal (Maroc) et Maghreb
Accueil des délégations marocaines, tunisiennes et françaises à l’UBO à l’occasion des réunions internationales des PHC Toubkal (Maroc) et Maghreb
Du 21 juin au 25 juin, l’IUEM a accueilli les membres des comités des Partenariats Hubert Curien (PHC) « Toubkal » et « Maghreb » à l’occasion de la tenue de leurs sessions annuelles.
Les partenariats Hubert Curien (PHC) soutiennent les échanges scientifiques et technologiques internationaux du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE), avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Les sessions organisées à Brest permettent de procéder à la sélection de nouveaux projets de recherche concernant toutes les disciplines scientifiques et de faire le point sur ces Partenariats avec le Maroc, la Tunisie et la France.
La délégation du PHC « Maghreb » était constituée de la Directrice du CNRST au Maroc, Mme Jamila EL ALAMI, du Directeur Général de la Recherche Scientifique en Tunisie, M. Mourad BELLASSOUED, du coordinateur du PHC MAGHREB, Jacques DEVERCHERE, des co-présidents français des comités bilatéraux, des attachés scientifiques des Ambassades de France à Rabat et Tunis, et des représentants des Ministères impliqués des 3 pays. Près de 40 projets déposés sur le site de Campus France PHC MAGHREB ont été discutés entre les partenaires.
La délégation du PHC « Toubkal » était quant à elle constituée de la co-présidente marocaine du Comité, Directrice du CNRST au Maroc, Mme Jamila EL ALAMI, du co-président français du Comité, M. Valery BOTTON, de l’attaché scientifique de l’Ambassade de France à Rabat, des représentants des Ministères impliqués et de 14 experts scientifiques tunisiens et français chargés de l’évaluation de plus de 100 projets déposés sur le site PHC TOUBKAL de Campus France.
Les sessions se sont tenues à l’IUEM et au PNBI et se sont déroulées dans une ambiance très cordiale et constructive.

Contact : Jacques Déverchère, UBO-IUEM et Cécile Berry