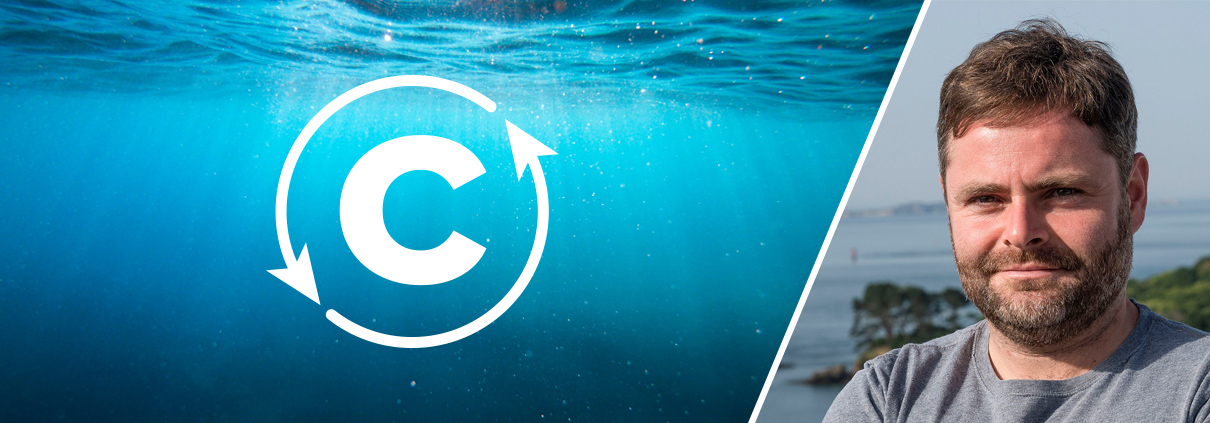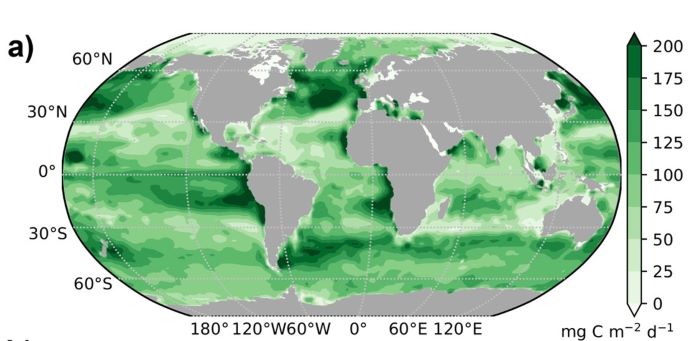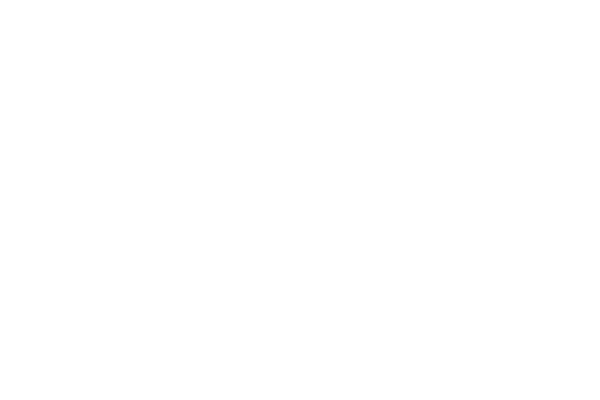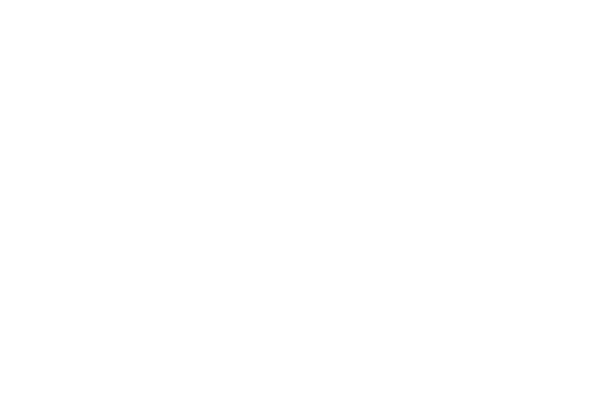« L’histoire insoupçonnée de l’huître » : Stéphane Pouvreau invité de la Terre au carré
Notre collègue Stéphane POUVREAU était, au côté de Catherine Dupont (archéomalacologue au CNRS), invité de l’émission « La Terre au Carré » du 4 février sur France Inter.
Menée par Mathieu VIDARD, cette émission intitulée « L’histoire insoupçonnée de l’huître » revient sur l’histoire mouvementée de ce coquillage emblématique de la gastronomie.
Présente sur Terre depuis plus de 150 millions d’années, l’huître a marqué l’histoire humaine, de la préhistoire à nos jours. Les chasseurs-cueilleurs se délectaient déjà de ce mollusque il y a 8 000 ans. Avec l’Antiquité, elle devient un mets de luxe prisé par les Romains, qui innovent en ostréiculture. Au Moyen Âge et à la Renaissance, l’huître incarne le raffinement, appréciée par les monarques comme Louis XIV et Louis XVIII. Cependant, l’huître a souvent frôlé l’extinction, victime de la surpêche et des maladies. Le XXe siècle voit l’huître plate décimée, remplacée progressivement par des variétés importées, principalement l’huître creuse japonaise que nous consommons aujourd’hui.